Que faut-il pour que „la vie normale“ ait une chance? Préface pour Astrid Astolfi
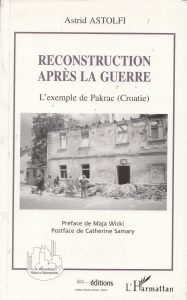 Vorwort für: Astrid Astolfi, “Reconstruction après la Guerre – L’exemple de Pancrac (Croatie), ies éditions, institut d’études sociales Genève 1999, ISBN 2-88224-049-X
Vorwort für: Astrid Astolfi, “Reconstruction après la Guerre – L’exemple de Pancrac (Croatie), ies éditions, institut d’études sociales Genève 1999, ISBN 2-88224-049-X
Que faut-il pour que „la vie normale“ ait une chance? Préface pour Astrid Astolfi
„Depuis 1945, il n’y avait jamais autant de haine entre les nations qu’aujourd’hui…. Il s’agit d‘un mouvement nouveau, d‘un accroissement du nationalisme. Cela mène toujours à la guerre. Le nationalisme mène au fachisme, et le fachisme, pour se maintenir en vie, a besoin de la guerre[1].“
Il me semble qu’il ne suffit pas de constater cette haine croissante qui a mené à la barbarie des „purifications éthniques“ et des déportations en masse de centaines de milliers d‘hommes, de femmes et d’enfants, à la destruction non seulement de leurs maisons, de leur villages et villes, mais de leur intégrité de vie, qui finalement a mené à la dévastation consécutive, à la dévastation politique, morale et matérielle de cette ex-Yougoslavie avec sa grande diversité de cultures, de religions et d’histoire. Ce qu’il faudrait savoir, c’est pourquoi cette haine, propagée par les dirigeants avides de pouvoir nationaliste, eut tant d’acceptation et tant de support dans la population de Croatie, de Serbie et de Bosnie. Quelles en sont les racines, et quelles en sont les conséquences? Et surtout, si la paix, si „la vie normale“ ont encore une chance après tant violence exercée et tant de souffrance subies, après tant de détresse humaine et tant de destruction sociale et culturelle, bref, après tant de dégâts intérieurs et extérieurs?
Voilà qu‘une jeune femme tessinoise, de langue maternelle italienne, engagée dans le travail pacifiste et interculturel, étudiant a l’Institut d’Etudes Sociales (IES) et à l’Ecole Supérieure de Travail Social (ESTS) à Genève, joint un groupe de volontaires et se rend avec eux à Pakrac, petite ville croate, pour y reconstruire d’une part des maisons détruites au cours des combats entres Serbes et Croates en 1991, et d’autre part pour contribuer à restituer „la vie normale“ par le modèle vécu d‘une vie collective interculturelle. Pour ces jeunes volontaires, il ne s’agissait pas en premier lieu d’apporter une aide humanitaire au sens strict, mais plutôt une entraide sociale, c’est-à-dire une contribution active à une réconciliation de la population divisée en camps ennemis, tout en faisant du travail de menuisiers, de charpentiers et d’électriciens, sachant que „la maison“ constitue plus qu‘une valeur matérielle, et que des gens dépourvus de leur abri sont peu enclins à pardonner à ceux qui l’ont brûlé.
Astrid Astolfi, ayant en tête les questions-clé de sa recherche et un intérêt politique et social nourri d’un profond besoin de réconciliation, ne put pas s’imaginer l’envergure des problèmes, pétrifiés dans les ruines et décombres de la petite ville divisée par une ligne de cessez-le-feu, où du côté croate de nombreuses ONGs contribuaient à la reconstruction, où il y avait l’électricité et le téléfone et un déblayage constant des ruines de guerre, mais où l’eau manquait, dont disposait le côté serbe. L’eau était du côté serbe un des rares atouts; autrement tout y était figé et tout y faisait faute. Pour les Serbes de Pakrac, il n’y avait que les Nations Unies qui apportaient un support alimentaire et médical. Cette ligne de cessez-le feu était une frontière ennemie constante, malgré le projet de l’ONU de septembre 1992 et le mémorandum consécutif de février 1993 qui proposaient de réparer les dégats de guerre, de deminer les champs, de reconstruire les maisons et de faciliter le retour des personnes déplacées et réfugiées. Tous ces programmes restaient ineffectifs, ils n’étaient que des appels sur le papier.
De nouveau, il faut demander pourquoi. Quel était le problème inhérent à ces programmes et appels qui empéchait qu’ils soient mis en oeuvre? Le fait est que d’une part ils étaient dictés par des autorités extérieures, la plupart du temps en collaboration avec les „war-lords“ et d’autres responsables de violence et de crimes, et furent par cela-même rejetés par la majorité de la population. D’autre part ils s‘adressaient uniquement à un pragmatisme rationel, sans considérer le côté émotif des gens qui est dominé par un mélange confus de sentiments négatifs, dont l’humiliation, la honte et la haine, la souffrance de profondes blessures intérieures. Ces sentiments sont souvent légués d‘une génération à l’autre, étant le résultat d’anciennes plaies non guéries, et en même temps ils jaillissent d‘expériences personnelles. Quelle que soit leur génèse, ils engendrent le besoin de revendication et de réparation, et ils sont partagés par la plupart des victimes et des aggresseurs (qui expliquent leur aggression par la propre victimisation), et non seulement par les individus, mais aussi par les collectivités. Ces sentiments prêtent un terrain émotif fécond pour les idéologies nationalistes et éthnicistes, et les responsables, qui en proclament et divulguent les programmes, s’en servent pour continuer à justifier leurs pratiques de haine, de mépris et de dénigration des autres, de mensonges et d’agression – et, ce qui est encore plus néfaste, de „gloire“ et d’identité héroïque pour ceux qui les suivent.
Les recherches d’Astrid Astolfi la mènent en plein dans ce cercle vicieux qui définit les conditions politiques et sociales du quotidien de la petite ville de Pakrac, mais peu à peu elles se concentrent aussi sur les conditions de vie et d’échange du groupe international des jeunes volontaires. Astrid Astolfi les examine de près, et elle en rapporte minutieusement le processus. L’entrain commun du début fait peu à peu place à l’apparition de grandes différences de personnalité, d’expérience et de compétence, d’aptitudes psychiques, techniques ou manuelles, de savoir et de pouvoir. Apparemment, c’est la question du côté serbe et des empêchements politiques et humains tout autour qui devient une cause pricipale de préoccupation et d’irritation constante. Ce n‘est qu‘à postériori qu‘il est possible de comprendre qu’il y avait – au niveau de l’inconscient – un transfert de sentiments négatifs paralysants entre les jeunes volontaires et les habitants des deux côtés de Pakrac, surtout de méfiance, de peur et d’attribution de fautes. S’il n’y avait eu que les empêchements extérieurs et les manques de structure intérieures dans l’organisation du travail des volontaires, cela n’aurait probablement pas suffi à créer les crises déchirantes, le durcissement des positions de quelques uns et le desarroi de quelques autres, cela n’auait pas suffit à menacer le projet entier. L’accident mortel d’un jeune membre du groupe des volontaires fit sentir la „déchirure“ intérieure à la plupart des participants. En plus du choque douloureux de la perte d’un copain, sa mort avait une signification symbolique pour tous et toutes.
Aujourd’hui, en temps de guerre réactivée, où le Kosovo est quasiment „purifié“ de la population albanaise et qu’il est en grande partie rendu inhabitable soit par les destructions militaires directes, soit par les bombardements de l’OTAN, où les énormes dégâts politiques et matériels ne sont que les traces visibles des dégâts beaucoup plus profonds dans l’âme et le corps de centaines de milliers d’enfants, d‘hommes et de femmes, dans leur histoire et leurs possibilités de vivre ensemble, il est urgent de s’occuper avec la plus grande attention des conditions douloureuses d’une réparation des ces traumatismes individuels et collectifs, c’est-à-dire d’une réconciliation qui pourrait amener à une paix durable.
Mais pour qu’une paix soit durable, il ne faut pas seulement faire passer le temps. Il est nécessaire que les crimes commis soient punis, que les plaintes et les accusations puissent être formulées et soient écoutées. Il faut une volonté de réparation qui doit correspondre à un grand respect des besoins personnels de tous ceux et toutes celles qui ont souffert. Les anciens et les nouveaux conflits doivent être pris au sérieux, pour pouvoir être gérés et supportés sans que la violence intervienne. Et surtout, il faut une réhabilitation du besoin fondamental de vivre en dignité, de vivre sans peur et sans le sentiment rongeant du mépris et de la méfiance. La satisfaction de ce besoin n’est pas un privilège réservé à quelques groupes qui conviennent à certains critères „éthniques“ ou politiques, mais c’est un droit humain, et c‘est la pluralité des hommes et des femmes dans leur différence d’origine, de croyance ou de langue qui en sont les sujets. Car seulement ce respect de la différence peut garantir le respect de la même humanité en chaque individu et en chaque collectivité. C’est un long apprentissage qui mène de la souffrance au contrôle et au rejet de tout abus de pouvoir.
La recherche d’Astrid Astolfi sur les conditions de „guerre interrompue“ dans la petite ville de Pakrac pourrait contribuer à comprendre davantage les péripéties et la fragilité de ce processus de „guérison“ politique et humaine, et elle pourrait encourager à en appliquer les effets pratiques et théoriques dans les échanges quotidiens, toujours interculturels dans le monde actuel et, malheureusement, toujours impregnés de peur ou de violence. Si les conditions de vie de chaque être humain pouvaient passer du stade de „guerre interrompue“ à une réconciliation avec sa propre histoire et, par conséquent, avec ses perspectives d’avenir, beaucoup serait fait pour une paix durable non seulement dans l’ex-Yougoslavie humiliée et tourmentée, mais partout en Europe et partout ailleurs. Les histoires sont différentes, mais les besoins humains se ressemblent.
[1] Marek Edelman, un des commandants et survivant de l’insurrection dans le ghetto de Varsovie de 1943, au sujet de la guerre en Bosnie. Interview donné à Johannes Vollmer, dans „Dass wir in Bosnien zur Welt gehören“, Benziger Verlag, Solothurn/Düsseldorf 1995, p. 172.








